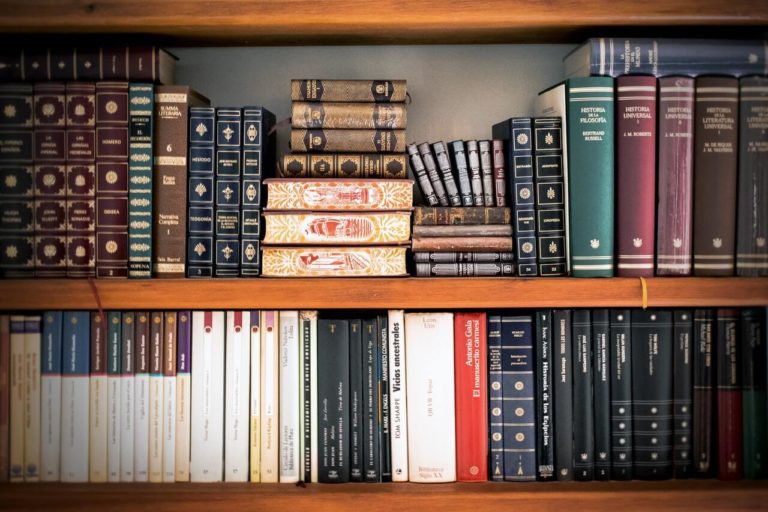Parmi les redressements fiscaux vécus comme des injustices, ceux portant sur les « management fees » défraient régulièrement la chronique. Ce vocable anglais désigne les prestations payées par une société cliente à une société prestataire en échange de services liés à sa gestion et sa direction. Sociétés cliente et prestataire sont souvent membres d’un même groupe, ou ont des dirigeants issus d’une même communauté d’intérêts.
Ces redressements fiscaux donnent lieu à des rectifications significatives puisque la charge d’honoraires est rejetée de la déduction de la base soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) chez la société cliente, qui perd également son droit à déduction de la TVA.
Cela conduit à une double taxation des sommes puisque, dans la majorité des cas, le produit de management fees aura été taxé à l’IS chez la société prestataire qui aura également collecté la TVA.
Pis, une société prestataire qui engagerait des dépenses au profit d’une société tierce sans les refacturer se rendrait coupable d’un acte anormal de gestion répréhensible, ce qui implique donc que les management fees sont un outil de conformité fiscale devenu une hantise pour les groupes de sociétés.

A l’origine, des attaques de l’administration fiscale
La cible numéro une de ces attaques de l’administration est le cas où deux sociétés ont le même dirigeant personne physique, une seule le rémunérant intégralement tout en refacturant à l’autre une prestation externalisée de direction. S’il semble logique économiquement que la société cliente supporte un coût en contrepartie du bénéfice du travail du dirigeant commun, le motif de redressement invoqué par l’administration est qu’il est anormal que la société cliente paye des honoraires à une société tierce pour le travail d’un dirigeant dont elle dispose déjà au travers du mandat social qu’elle lui a confié. Ainsi, la société prestataire n’apporterait aucune contrepartie aux management fees payés par la société cliente, caractérisant un acte anormal de gestion.
De l’arrêt Gamlor en 2003[1] à aujourd’hui, en passant par Self Media en 2019[2], les décisions des juridictions administratives se suivent et donnent inlassablement raison à l’administration fiscale dans ces redressements au bazouka.
Seul un bref rayon de soleil est apparu en octobre 2023, donnant lieu à une allégresse inédite sur les réseaux sociaux professionnels, lorsque le Conseil d’Etat annula un arrêt défavorable au contribuable dans une décision connue sous le nom de Collectivision[3]. Certains voulurent voir dans cet arrêt un éclair de lucidité du juge de l’impôt enfin sensible à la réalité économique de l’opération, à savoir celle d’un jeu de vases communicants.
Il faut dire que pour fonder sa décision, le Conseil d’Etat a bénéficié de remarquables conclusions de la rapporteure publique Émilie Bokdam-Tognetti dans lesquelles elle appelle de ses vœux à « tenir compte de la finalité réelle de ces opérations et du montage » et « adopter une approche économique globale du jeu à trois » entre la société cliente, la société prestataire et le dirigeant commun.
Toujours dans ses conclusions, elle rappelle que l’acte anormal de gestion ne consiste pas à se prononcer sur la « substance » de la société prestataire ou sur l’« objectif poursuivi » potentiellement frauduleux du montage mis en place, ces griefs ne pouvant être attaqués que par l’angle de l’abus de droit.
Au fond, dès lors qu’il n’est pas remis en cause que le dirigeant réalisait des prestations au profit de la société cliente, l’appauvrissement de cette dernière par le paiement des management fees n’est caractérisé que lorsque l’administration démontre l’absence de lien entre cette charge et les prestations réalisées.
Ainsi, dans l’arrêt d’appel annulé[4] par le Conseil d’Etat, la cour d’appel validait le redressement fiscal au motif que les associés de la société cliente (Collectivision) avaient pris la décision de ne pas rémunérer le mandat social du dirigeant personne physique, tirant ainsi la conclusion que la charge de management fees appauvrissait une société qui entendait bénéficier gratuitement du travail de son dirigeant.
Or, le Conseil d’Etat relève à très juste titre que cette décision des associés est limitativement l’expression de la volonté de ne pas rémunérer directement ce dirigeant, par exemple via une fiche de paie, mais ne saurait en aucun cas infirmer que « la société Collectivision ait pu décider, en procédant à la passation de la convention en cause avec la société (prestataire), de verser une rémunération indirecte à son gérant en contrepartie de l’exercice de ses fonctions ».
Ne jugeant que sur l’application du droit et non sur le fond, le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille[5] qui a revu sa copie en avril 2025 en jugeant insuffisante la démonstration d’ « une volonté de rémunérer sous une forme indirecte les fonctions accomplies par (le dirigeant) en tant que gérant de la société », soulignant que la société Collectivision « n’établit pas que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement (le dirigeant) ».
Cette affaire Collectivision, bien qu’à l’issue défavorable pour le contribuable, a le mérite de proposer une porte de régularité des management fees dont l’enthousiasme à l’ouvrir est douchée par la considération de l’autonomie du droit fiscal.
Ne pas oublier le risque juridique
En effet, si la déductibilité fiscale des management fees apparaît justifiée lorsque la société cliente reconnait explicitement, par exemple dans un procès-verbal d’assemblée générale ou dans ses statuts, qu’ils rémunèrent indirectement le mandat social de son dirigeant, elle ne saurait emporter une régularité juridique de la convention.
Or, parmi les contentieux les plus célèbres en matière de management fees, certains sont de nature commerciale et civile[6]. Ces affaires sont le résultat de conflits entre associés et dirigeants dans lesquels la reconnaissance de la nullité de la convention de management fees pour absence de cause conduit au remboursement des honoraires indument perçus par la société personnelle du dirigeant.
Si, selon Émilie Bokdam-Tognetti, le droit fiscal peut s’accommoder d’une « autre façon de voir, consistant à appréhender de manière plus globale l’ensemble de ces relations, à travers une focale que d’aucuns diront plus économique et plus réaliste », il n’en est pas de même en droit des sociétés. Ainsi, une convention de management fees peut être nulle juridiquement, sans remettre en cause la déductibilité fiscale de la charge.
L’émergence d’un nouveau risque : le social
Mais au-delà de ce risque juridique déjà connu, aujourd’hui, un nouveau front s’ouvre sur le champ de bataille : celui du risque social.
Pour qui s’est déjà frotté aux attaques de l’URSSAF, il semble absolument inconvenable, si ce n’est inconscient, d’imaginer lui opposer un schéma de « rémunération indirecte » d’un dirigeant sans s’attendre à ce qu’elle s’interroge sur l’assujettissement de ces sommes aux cotisations sociales dont elle a la charge du recouvrement.
D’ailleurs, toujours dans ses excellentes conclusions, Émilie Bokdam-Tognetti prend soin de commenter un schéma « susceptible de tendre au contournement de certaines règles du droit social, qu’il s’agisse par exemple pour la société (cliente) d’éviter le paiement de charges sociales en substituant au paiement d’une rémunération à son gérant le versement d’honoraires de prestations de services à une société tierce. (…) La décision de verser à son gérant ou dirigeant une rémunération indirecte plutôt que directe (…) peut même, lorsque le montage permet d’éviter le versement de cotisations sociales, réduire la charge liée à la rémunération des fonctions de direction. La pratique est peut-être pendable, voire susceptible, si tant est qu’elle n’ait eu d’autre but, de caractériser une fraude aux cotisations sociales ».
Nous ne doutons pas qu’URSSAF et autres organismes sociaux ont pris soin de noter ce précieux commentaire.
Dans les actualités récentes du contentieux social, il transparait une volonté des organismes sociaux d’assujettir aux cotisations sociales les revenus issus du travail, indépendamment de leur qualification juridique ou fiscale. Ainsi, à la stupeur générale, la Cour de cassation a confirmé le 19 octobre 2023[7] un redressement de cotisations retraite sur les dividendes versés par une société d’exploitation (SELARL) à sa holding (SPFPL), au motif que « que les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d’exercice libéral ».
Ainsi, la Cour de cassation privilégie l’origine du flux (le travail du professionnel dentiste au sein de la SELARL) à sa qualification juridique (dividende versé à une holding interposée) pour en déduire le traitement social applicable (assujettissement aux cotisations).
Cet arrêt est considéré par beaucoup comme un cas d’espèce puisque l’affaire se situe dans un contexte où le dirigeant venait de réaliser un cash-out via un rachat à soi-même des titres de sa SELARL via la SPFPL, lui permettant de limiter excessivement sa rémunération dans la société d’exploitation.
Des parlementaires ont interrogé le ministre de l’économie et des finances pour qu’il confirme le caractère « exotique » de cette décision. Dans sa réponse du 21 août 2025[8], le ministre affirme que « cet arrêt ne saurait être regardé comme un arrêt de principe » au motif que « la Cour a certainement entendu tirer les conséquences d’une situation précise dans laquelle l’interposition d’une société holding n’a pu avoir pour autre objet que de contourner la législation sur la réintégration de certains dividendes distribués à un travailleur indépendant au sein de l’assiette de cotisations et de contributions sociales de celui-ci ».
Un cas d’espèce ? Remplacez « société holding » par « société prestataire » et « dividendes distribués à un travailleur indépendant » par « rémunération versée à un dirigeant assimilé-salarié », vous obtenez le texte d’une réponse ministérielle qui sera publiée dans les années à venir en réponse à une question parlementaire sur un arrêt social en matière de management fees.
Ça n’est qu’une question de temps car, si le risque social du management fees est resté longtemps dans l’angle mort du rétroviseur, le contentieux était déjà bien là. Ainsi, dans une décision du 7 juillet 2023[9], la cour d’appel de Paris s’est prononcée dans une affaire où l’URSSAF avait assujetti aux cotisations sociales des management fees de 24 000 € et 12 000 € annuels, au motif que « les attributions dévolues (au dirigeant) au terme de cette convention correspondent dans les faits à celles qu’exerce habituellement un président de SAS au titre de son mandat social en application de l’art. L 227-6 du C.com. Dans ces conditions, les rémunérations de prestations rendues par (le dirigeant) sous la forme de « managment fees » par l’intermédiaire de la (société prestataire) doivent être soumises aux cotisations et contributions sociales dues au régime général de la sécurité sociale ».
Cette affaire n’a pas eu d’échos parce que la cour d’appel a donné tort à l’URSSAF au motif qu’elle écartait « la convention (de management fees) en raison de son caractère présumé fictif, se référant implicitement à la notion d’abus de droit, en sorte qu’elle aurait dû respecter la procédure spécifique de répression des abus de droit et informer le cotisant de la possibilité de saisir le comité d’abus de droit ».
L’URSSAF s’est donc cassée les dents sur un problème de procédure, dispensant le juge de se prononcer sur le fond. La procédure de l’abus de droit social étant en sommeil depuis sa création, le législateur a entendu simplifier la vie de l’administration sociale en l’allégeant drastiquement par la suppression du comité de l’abus de droit dans la loi de financement de la sécurité sociale 2024.
Nous étions donc dans l’attente d’une décision de fond, et la première a été rendue le 3 juillet 2025[10] par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Dans cet arrêt, le juge rappelle que « En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations » et que « L’inspecteur du recouvrement constate que le contrat, ayant pour but de rémunérer (le dirigeant) au travers de la (société prestataires) pour des prestations qui étaient accomplies par lui-même au titre de ses fonctions sociales, est dépourvu de cause ».
En prenant soin de démontrer que les prestations fournies dans le cadre de la convention sont celles qui incombent au dirigeant dans le cadre de son mandat social, la cour d’appel en conclut que « les fonctions exercées par (le dirigeant) sont celles d’un dirigeant d’une SA, de sorte que les sommes versées par la (société cliente), sous le couvert de la facturation produite par (la société prestataire), au profit de son dirigeant » et que c’est à bon droit qu’elles « ont été intégrées à l’assiette des cotisations sociales ».
Cet arrêt confirme que les prescriptions du Conseil d’État dans l’affaire Collectivision portent en elles les germes d’un risque majeur d’assujettissement aux cotisations sociales des management fees qualifiés de rémunération indirecte d’un mandat social.
Faut-il désespérer et abandonner la bataille ? Certainement pas !

Retour sur le point de départ des contentieux : le double emploi !
Tout d’abord, il est essentiel de rappeler que le point de départ de tous les contentieux (juridiques, fiscaux, sociaux) est la problématique de double-emploi (fiscal et social) ou absence de cause (juridique) liée au fait que le mandat social et la convention de management couvrent des périmètres d’intervention identiques. En effet, il est illusoire de vouloir démontrer qu’un dirigeant personne physique mandate une société tierce dans laquelle il est la seule ressource opérationnelle pour se conseiller lui-même.
Il faut donc assumer l’accomplissement personnel des fonctions de dirigeant et prestataire, tout en démontrant qu’elles appartiennent à des périmètres différents. La question posée est donc de savoir ce qui est une mission rattachée au mandat social, et ce qui est une mission de nature technique dont la prestation peut venir d’une société tierce. La réponse n’est pas absolue, et l’administration se montre souvent subjective en la matière.
Ainsi, dans la décision précitée en matière sociale du 3 juillet 2025, le juge indique que rien ne permet de vérifier que le dirigeant personne physique « n’apporte que son expertise technique distincte de son expertise en gestion de l’entreprise quand il assure le suivi de certains chantiers techniques ». Un tel suivi serait donc rattaché au mandat social, alors qu’il parait technique par nature.
A l’inverse, dans son BOFIP[11] relatif à la distinction de la rémunération du mandat social et de la rémunération technique des associés de sociétés d’exercice libéral, l’administration fiscale retient une décision bien plus étroite des fonctions de direction en citant les exemples de « convocation d’assemblée, représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers, décision de déplacement du siège social de la société », puis en précisant que sont techniques les fonctions d’« encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ».
Dans un jugement de novembre 2017[12] relatif à un contentieux sur des management fees, le tribunal administratif de Nancy donne une grille de lecture intéressante sur la frontière entre prestations de direction et prestations techniques. Le juge indique ainsi qu’ « à la différence de décisions techniques ou d’application qui ne relèvent pas du mandat social de dirigeant, les tâches inhérentes aux fonctions normales de président d’une société par actions simplifiées (SAS) sont celles qui relèvent de décisions stratégiques de l’entreprise » et « que pour déterminer si les missions confiées relèvent normalement du mandat social de dirigeant, le juge de l’impôt doit notamment prendre en compte l’objet social de la société, la rédaction de ses statuts, son volume d’activité et sa dimension nationale ou internationale ».
Le juge identifie ainsi quatre critères, dont trois font subjectivement référence à l’activité et la taille de l’entreprise. Le quatrième se réfère à la « rédaction des statuts » et mérite une attention particulière. En effet, si par principe le gérant de SARL ou le président de SAS dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir dans l’intérêt de la société, la loi permet de déroger en limitant ce périmètre dans l’ordre interne.
Ainsi, la rédaction d’une clause statutaire définissant les pouvoirs du mandataire social avec précision, limitant le risque d’interprétation d’une rédaction trop générale octroyant tout pouvoir, doit clairement être privilégiée.
En décembre 2018[13], la Cour de cassation a eu à se prononcer sur un litige entre un dirigeant et des associés ayant abouti à ce que ces derniers réclament la nullité de la convention de management fees dont bénéficiait le premier. La cour n’a pas reconnu la nullité de la convention au motif que « les missions de la société (prestataire) définies au contrat de services ne se confondent pas avec celles du (dirigeant personne physique) au titre de sa fonction de président de la société (cliente) ». Dans cette affaire, le juge a relevé à très juste titre que les périmètres du mandat social et des conventions étaient définis avec précision.
En effet, l’article 16 des statuts de la société cliente limitait les pouvoirs de son dirigeant à la convocation de l’assemblée générale et à quelques décisions stratégiques, tandis que la convention de management fees portait sur un champ d’intervention relatif à la « gestion et développement des activités de la branche sécurité, définition des stratégies, relations avec les clients, axes de développement de son chiffre d’affaires, gestion de ses usines, adaptation de ses actifs industriels et des moyens humains et de production ».
La lecture de ces deux actes juridiques n’appelle aucune ambiguïté sur un éventuel chevauchement de leurs périmètres, ce qui démontre que la rédaction des statuts est un élément essentiel dans les schémas impliquant des conventions de mangement fees.
Retour sur le point de départ des contentieux : le double emploi !
En dernier lieu, nous devons évoquer l’hypothèse de désignation de la personne morale prestataire comme mandataire social de la société cliente. Cette solution clôture le problème du double-emploi puisque la personne morale prestataire est elle-même dirigeante de la société cliente. Ses facturations rémunèrent ainsi son propre mandat social.
Chaque fois que cela est possible, cette option doit être mise en œuvre. Il existe toutefois des situations dans lesquelles cette faculté n’est pas ouverte, par exemple lorsque la société cliente est une société anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (SARL) puisque ces formes juridiques interdisent la désignation d’une personne morale dirigeante. S’agissant de la société par actions simplifiée (SAS) et de la société civile, la loi autorise une telle désignation sauf dans les hypothèses où elles exercent des professions réglementées qui interdisent des mandataires sociaux personnes morales. C’est par exemple le cas des professions médicales, des conseillers en investissements financiers (CIF) ou encore des sociétés de sécurité agrées par le CNAPS.
En pareille situation, il n’est plus possible pour l’administration fiscale de caractériser un acte anormal de gestion dans la mesure où la société cliente ne bénéficie plus du travail du dirigeant personne physique autrement que par l’existence de la facturation de ce mandat social de la société prestataire. En droit social, il nous semble que l’attaque de l’URSSAF sera contrariée pour les mêmes raisons. Mais dans les deux cas, le risque principal serait que la société de facturation soit une coquille vide qui conduise à la considérer comme fictive, voire abusive. C’est pourquoi nous ne pouvons que conseiller de veiller à la consistance de ces structures d’externalisation de la rémunération dont les flux ne doivent pas se limiter à une stricte stratégie d’encapsulement.
Ainsi, dans un arrêt de 2021 , la cour d’appel de Poitiers a confirmé l’existence d’un abus de droit en matière sociale dans une affaire où la société prestataire (EURL) possédait le mandat social de la société cliente (SAS), assujétissant aux cotisations sociales les management fees facturés au titre dudit mandat. Pour appuyer leur position, le juge et l’administration retiennent notamment que la société prestataire « n’avait pas développé une autre activité significative que celle de mandataire social de la (société cliente) » et qu’elle s’était engageait « à n’exercer aucune activité professionnelle » lors de sa désignation. Dans cette affaire, le dirigeant personne physique de la société prestataire était précédemment salarié de la société cliente, avant de créer son EURL au moment de sa prise de retraite pour réaliser la même mission qu’auparavant « au travers de (sa) société patrimoniale.
Par ailleurs, le risque repose sur la reconnaissance d’une rémunération excessive dans l’hypothèse où la rémunération de mandat facturée couvre en réalité des dépenses qui sont techniques par nature. Ainsi, dans les groupes ayant des holdings fournissant plusieurs natures de services, la désignation de la personne morale comme mandataire social de la société cliente ne permet pas de s’exonérer d’un travail de distinction entre les prestations techniques devant faire l’objet de conventions de services, et les prestations de direction couvertes par le mandat social.
En tirant la ficelle de la peur, nous pourrions d’ailleurs imaginer que l’administration fiscale rejette partiellement la rémunération excessive du mandat social chez la société cliente, et rejette la déduction des dépenses « techniques » supportées par la société prestataire au motif qu’elles n’ont pas donné lieu à refacturations, ce qui constitue un acte d’appauvrissement anormal. Nous passerions donc d’une double taxation, à une triple !
Quelle conclusion en tirer ?
En conclusion, l’abondante jurisprudence fiscale et commerciale nous permet d’y voir plus clair aujourd’hui sur les précautions à prendre en matière de conventions de management fees. Il est évident que la désignation de la société prestataire en qualité de mandataire social, chaque fois que cela est possible, est à privilégier, même si cela n’est pas sans ouvrir d’autres zones de risques. Nous pensons également que la rédaction de clauses statutaires définissant avec précision les pouvoirs attachés au mandat social est fondamentale.
Si l’arrêt Collectivision ouvrait une porte intéressante en fiscal, il semble évident que celle-ci ne doit pas être franchie au risque de se retrouver confronté à une administration sociale qui multiplie les attaques sur les schémas d’externalisation ou d’encapsulement de rémunérations.
Dans cette vaste thématique source d’incertitudes renouvelées, le seul ilot de certitude est que les management fees continueront d’alimenter les articles et les jurisprudences dans les années à venir.
[1]Cour administrative d’appel de Nancy, 9 octobre 2003, 98NC02182
[2] Cour administrative d’appel de Paris, 6 novembre 2019, 18PA02628
[3] Conseil d’État, 4 octobre 2023, n°466887 [4]Cour administrative d’appel de Marseille, 23 juin 2022, 19MA04862
[5] Cour administrative d’appel de Marseille, 3 avril 2025, 23MA02484
[6] Cour de cassation, 14 septembre 2010, 09-16.084 – Cour de cassation, 23 octobre 2012, 11-23.376
[7] Cour de cassation, 19 octobre 2023, 21-20.366
[8] Question de Claude MALHURET publiée le 10 octobre 2024 [9]Cours d’appel de Paris, 7 juillet 2023, n° 19/07066
[10]Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, n° 24/05530 [11] BOI-RSA-GER-10-30
[12] Tribunal administratif de Nancy, le 30 novembre 2017, 1602742 1602743
[13] Cour de cassation, civile, 12 décembre 2018, 16-15.217
[14] Cour d’appel de Poitiers, 28 janvier 2021, N° 51